Le débat autour des droits fonciers des femmes au Burundi suscite des polémiques, depuis des années. Celles-ci sont alimentées par des discours contradictoires et parfois infondés. Tandis que certains affirment que la tradition burundaise interdit catégoriquement aux femmes d’hériter des terres, d’autres estiment que le blocage se situe au niveau juridique. Pourtant, le droit comme les pratiques sociales isolées mais qui se généralisent démentent le discours dominant. Entre vérité et désinformation, Icatsi n’Ururo démêle les faits.
Il y a lieu, avant tout, de constater, contrairement aux idées reçues, que le cadre juridique est favorable aux droits fonciers des femmes. En effet, le Burundi a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux garantissant l’égalité des sexes en matière de droits fonciers.
Il adhère l’ONU en septembre 1962, ratifiant sa Charte et reconnaissant les principes universels de la DUDH qui, proclamant l’égalité des droits des hommes et des femmes dès son préambule, dispose, dans tout son premier article : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». En en janvier 1992, le Burundi ratifiera d’ailleurs la CEDEF (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ), renforçant son engagement en faveur de l’égalité des sexes.
Sur le plan national, l’article 13 de la Constitution de 2018 stipule que « tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité » et « jouissent des mêmes droits». L’article 22 renchérit, avec précision dans son alinéa 2 : « Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment (…) de son sexe ». Pourtant, en pratique, les femmes restent largement exclues de l’héritage foncier, en raison de la persistance de normes coutumières instrumentalisées et d’un vide juridique volontairement entretenu1 par l’autorité publique. Le blocage est institutionnel.
Une désinformation orchestrée pour justifier le statu quo

Une opinion, dont des responsables politiques, voudrait faire croire que les femmes elles-mêmes s’opposeraient à l’adoption d’une loi garantissant leur accès à l’héritage foncier. Il y a 5 ans, feu président Pierre Nkurunziza a, lui-même, faisant allusion à un « Non » en chœur des femmes auxquelles il demandait, en mars 2019 à Kayanza, si oui ou non elles voulaient la mise en place de la loi successorale, invoqué le rejet de cette loi par les femmes elles-mêmes, sans nuancer la validité de ce “non” en raison notamment du cadre de l’ interrogatoire2.
Les femmes soutiendraient ainsi les inégalités genrées, légitimeraient la domination masculine supposée naturelle, ancrée dans la culture. La discrimination serait voulue, assumée.
Bien sûr, il est facile d’accorder du crédit à ce raisonnement, si l’on n’y fait pas attention, surtout quand des femmes parfois d’une renommée, y compris d’envergure nationale, reproduisent à leur compte la même rhétorique auto-exclusive. Comme ce propos de la Première dame burundaise qui, en septembre 2020, a défrayé la chronique :
« Il y a aussi ce qui a été dit par la ministre de la Justice qui, lui aussi nous a prodigué des conseils. Elle a parlé au sujet de l’égalité des genres ; cela n’arrivera jamais, jamais ça ne réussira et jamais vous ne le verrez. (…) ce qui est de l’égalité homme-femme, oubliez ça d’abord ! Au Burundi, ça n’arrivera jamais ! »3 (Angéline Ndayishimiye, Première dame).
Loin de toute logique politique, ce discours masculiniste teinté de stéréotypes sexuées par une femme « éclairée » est évidemment symptomatique d’une intériorisation de la naturalité de la supériorité masculine y compris dans des classes sociales dotées d’un bon capital socio-culturel. Mais cette sociologisation n’est pas le propos de cette désinfox.
Le blocage, ce n’est pas la coutume
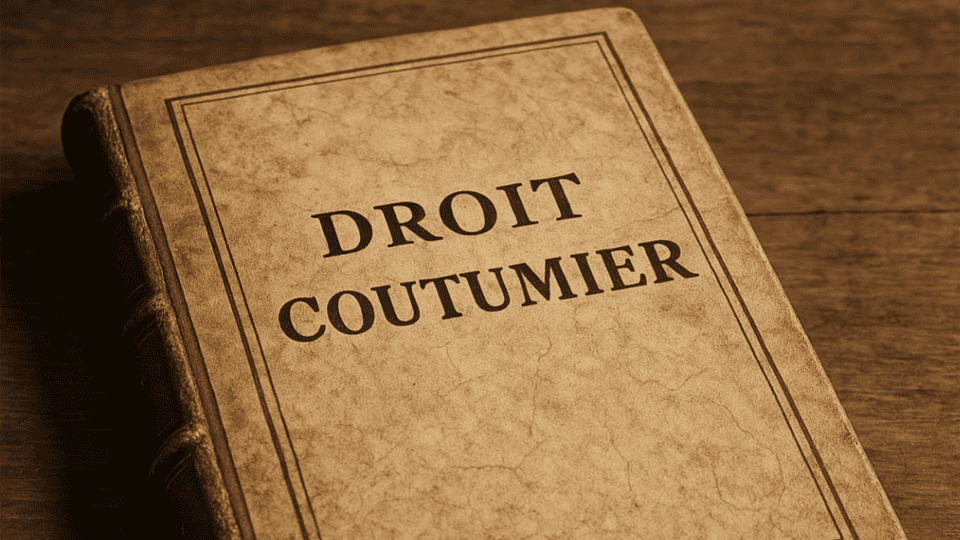
Le refus de la succession foncière aux femmes procède de la recherche de la monopolisation des ressources et du maintien de la domination masculine que de la coutume
Il reste en tout cas intéressant de constater que la référence à la tradition ou aux normes coutumières ne revient pas souvent dans l’argumentaire qui sous-tend ces discours. Ceux-ci empruntent plutôt des biais liés à la cohésion sociale, à l’entente familiale, à la sécurité publique.
Ceci est particulièrement clair dans un propos du président de l’Assemblée Nationale, Gélase Ndabirabe, fin 2021 :
« Le Gouvernement et d’autres instances proches de celui-ci ont posé la question aux différentes personnes, les adultes, hommes et femmes, et ces gens ont dit non. Ils ont dit qu’une loi sur la succession en faveur des filles et femmes occasionnerait beaucoup de problèmes. Si les gens s’entretuent actuellement, qu’en sera-t-il une fois que cette loi sera appliquée ? Restez donc prudents »4.
Le refus de l’accès à la terre pour les femmes procède, de fait, davantage des dynamiques systémiques discriminatoires visant la monopolisation des ressources et la dépendance socio-économique de la gent féminine dans des logiques de garantie de sa soumission. Pour rappel, plus de 90 % de la population vivent de l’agriculture, ce qui fait du contrôle de la terre un levier important du pouvoir des hommes et d’influence sociale en monopolisant ses ressources. Au Burundi, cet accaparement date seulement d’après l’indépendance à la suite du tournant néolibéral faisant du droit de propriété son fondement essentiel, la terre revêtant avant un statut collectif où femmes et hommes disposaient des mêmes droits5.

Plus de 90% de la population burundaise vivent de l’agriculture
L’autonomisation des femmes perturberait les rapports sociaux et le respect que les femmes doivent aux hommes ainsi que cela ressort de cet extrait du discours de la Première dame (voir supra) : « Nous nous sommes rendus compte qu’il y a un mauvais esprit de rébellion qui a attaqué les femmes qui ont de l’argent dans leurs poches »6 ou encore dans cette affirmation du feu président Nkurunziza :
« Les postes politiques entraînant la séparation de la famille ne servent à rien. J’en suis expérimenté, pendant les 15 ans que je dirige le Burundi, j’en suis témoin, l’exercice par les femmes de grands postes de responsabilités a été parfois un facteur de dislocation de leurs familles. Or, nous voulons des familles solides, nous ne voulons pas des familles qui se détruisent »7.
Ce registre de l’imaginaire sur le rapport entre l’avoir matériel de la femme (et/ou son statut social) et son domaine de respectabilité, permet, en lèvant le voile à toute logique culturaliste d’inégalités, de pointer ces enjeux de construction de la dépendance.
Les femmes réclament plutôt activement leurs droits fonciers
L’idée selon laquelle les femmes soutiennent ce régime d’un héritage foncier différencié est même factuellement fausse. En effet, des enquêtes indépendantes montrent que de nombreuses femmes réclament activement ce droit, notamment devant les tribunaux locaux où elles obtiennent gain de cause à hauteur de plus de 80 % des cas.

Les enquêtes de l’association APDH (Association pour la Paix et les Droits de l’Homme) faisaient état, il y a déjà quelques années, d’une augmentation significative d’année en année, de réclamations des droits fonciers par les femmes, y compris de succession, devant les structures judiciaires à la base. Des litiges fonciers, certains tribunaux de résidence enregistraient jusqu’à plus de 50% les réclamations déposées par des femmes8.
Il reste que les femmes qui saisissent les juridictions pour faire valoir leurs droits fonciers sont des femmes formées ou informées9, a priori celles des milieux urbains, qui constituent la minorité. N’empêche, la dynamique promet d’être positive, pour peu que des campagnes de sensibilisation demeurent.
Le lien entre le droit de succession pour les femmes et la sécurité publique est faux
L’hypothèse de dépravation de l’ordre social et d’un risque conséquent de trouble de l’ordre public que semblent brandir les défenseurs du statu quo ne tient pas non plus.
D’une part, vouloir légitimer la discrimination à l’héritage foncier en partant du constat que la criminalité foncière constitue déjà la première source d’insécurité10 trahirait un manquement aux responsabilités de la part de l’État qui n’assumerait pas des fonctions régaliennes tout en disposant du monopole de la violence physique légitime tel que théorisé par Max Weber.
On peut noter en passant que l’intensification des litiges fonciers trouve principalement sa source dans une ressource vitale qui se raréfie sous le coup de la pression démographique11.
D’autre part, ce prétexte nous a l’air d’une échappatoire étant donné que, hormis que cette égalité relève du domaine de la justice sociale, les différentes initiatives faites en ce sens en aval n’ont guère engendré de trouble à l’ordre public. Il est en effet généralisé, hormis les droits de succession obtenus après des procédures judiciaires, que les femmes célibataires et les femmes issues d’une descendance exclusivement féminine héritent la totalité de la propriété foncière de leurs parents. Par ailleurs, le patrimoine foncier acquis par les familles par achat est, de façon généralisée en milieu urbain mais aussi dans certaines familles des communautés rurales, partagé équitablement entre leurs descendants, filles et garçons sur le même pied d’égalité12.
Il est permis d’espérer…
Plusieurs pays africains, dont le Rwanda voisin, ont déjà franchi le pas en garantissant l’égalité des sexes en matière de succession. Le Burundi pourrait suivre cette tendance, mettre fin à une injustice historique et à une désinformation qui profite à certains au détriment de nombreuses femmes burundaises.
L’accès aux droits fonciers pour les femmes n’est pas une question de tradition, mais de justice et de développement. Il est donc crucial de combattre la désinformation qui alimente les inégalités et d’encourager un débat basé sur des faits juridiques et sociaux avérés.
NOTES
- La dernière proposition de loi relative à la succession, les régimes matrimoniaux et les libéralités date de 2011. Soumise au gouvernement, elle n’a pas avancé depuis.
Un projet de loi sur le code des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités avait vu son processus arrêté au Parlement en 2004. La jurisprudence, qui permettait aux juridictions de trancher équitablement sans discriminations en cas de litiges fonciers entre frères et sœurs, a été retoquée en août 2024 par le président de la Cour suprême.
↩︎ - La question fut lancée, comme à l’improviste, à une foule de femmes dont pas mal d’analphabètes non préparées et sous les caméras de journalistes. En réalité, on peut admettre qu’il s’agissait d’une manipulation préparée à l’avance, la réponse devant être instrumentalisée pour faire face au plaidoyer des féministes. ↩︎
- Discours d’Angéline Ndayishimiye, Première Dame du Burundi, le 5 septembre 2020. Ndayishimiye, Déo, Entre ma mère et Angéline Ndayishimiye, qui croire ? YAGA, publié le 7 septembre 2020 sur
https://www.yaga-burundi.com/2020/mere-angeline-ndayishimiye-qui-croire/ ↩︎ - YIKEZE, Alphonse, Droit de succession/Ndabirabe soulève un tollé chez les militantes de la cause féminine, Iwacu, publié le 15 novembre 2021 sur https://www.iwacu-burundi.org/droit-de-succession-le-sieur-ndabirabe-souleve-un-tolle-chez-les-militantes-de-la-cause-feminine/ ↩︎
- La terre au Burundi d’avant l’indépendance (1962) et quelques années après, avait un statut collectif et était gérée dans une logique lignagère qui ne consacrait aucune exclusion fondée sur le genre. La fille tout comme le garçon ne disposait que du droit d’usufruit, à étendue égale, sur la terre de leurs ancêtres. Aucun descendant, fille comme garçon, ne pouvait s’en approprier ou en transférer la propriété. C’est avec la poussée de la mondialisation que fut aboli l’«Ubugererwa» (servage) en juin 1977 et la terre perdit son statut collectif pour devenir une propriété individuelle dont la propriété pouvait être transférée dans une autre famille. C’est dans ce contexte de course à la richesse individuelle que débuta la discrimination de la femme burundaise et l’homme du passa du gestionnaire de la terre ancestrale à son propriétaire. ↩︎
- NDAYISHIMIYE, Déo, op.cit.
↩︎ - NIKIZA, Egide, Burundi : La parité en politique est un beau rêve mais irréalisable, Yaga, avril 2020. ↩︎
- APDH, « Droits fonciers des femmes au Burundi : le temps de l’action », Bujumbura, 2015, p.16. Disponible sur : https://www.yumpu.com/en/document/read/54541948/droits-fonciers-des-femmes-au-burundi-le-temps-de-laction ↩︎
- Il existe plusieurs projets de sensibilisation des femmes sur leurs droits pour lutter contre les discriminations dont elles sont sujettes, depuis plusieurs années. ↩︎
- RCN Justice & Démocratie, Statistiques judiciaires burundaises. Rendements, délais et typologie des litiges dans les tribunaux de résidence, RCN Justice & Démocratie (Bujumbura, décembre 2009), p.154. Disponible sur : https://rcn-ong.be/IMG/pdf/statistiques_judiciaires_burundaises.pdf ↩︎
- En effet, sur une superficie de 27.834 Km2, la population burundaise, 5 millions et 8 millions d’habitants selon les recensements de 1990 et de 2008, est estimée à 14 millions en 2024. Ainsi, il y a de moins en moins de terres pour de plus en plus de bouches à nourrir et de fait, la terre est la source majeure des conflits et d’insécurité dans le pays. Pour en savoir plus : ICG, Les terres de la discorde (I) : La réforme foncière au Burundi, Rapport Afrique No 213, Bruxelles, février 2014, p.2. Disponible sur : https://icg-prod.s3.amazonaws.com/fields-of-bitterness-I-land-reform-in-burundi-french.pdf ↩︎
- APDH, Op. cit, p.14 ↩︎




One thought on “Droits fonciers des femmes au Burundi : entre désinformation et réalités socio-juridiques”